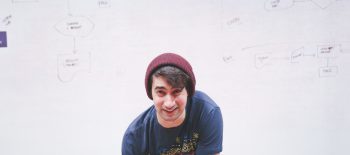L’imposition des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif
Il convient de tenir compte de certains éléments lors de l’imposition des entreprises individuelles ou des sociétés en nom collectif. Il faut avant tout distinguer entre fortune privée et fortune commerciale.
Dans cet article de blog, nous vous expliquons en détail comment fonctionne l’imposition des sociétés de personnes. À la fin de l’article, vous trouverez un tableau récapitulatif des informations les plus importantes.
Généralités
Les entreprises individuelles ne sont pas des entités fiscales indépendantes. Cela signifie que les revenus et la fortune de l’entreprise individuelle sont attribués au propriétaire de l’entreprise. De même, les sociétés collectives sont en principe traitées de manière transparente selon le droit suisse de l’impôt sur le revenu, et leurs revenus et leur fortune sont attribués proportionnellement à leurs associés et imposés avec leurs autres revenus et leur fortune (art. 10 LIFD).
La taxation du bénéfice imposable et de la fortune d’une entreprise de personnes ou de son propriétaire s’effectue selon une procédure en deux étapes :
- Dans un premier temps, le bénéfice imposable de l’entreprise est déterminé. Les entreprises de personnes qui tiennent une comptabilité régulière, c’est-à-dire une comptabilité commerciale, sont soumises aux mêmes règles de détermination du bénéfice que les personnes morales (cf. le renvoi à l’art. 58 LIFD à l’art. 18 al. 3 LIFD). Le bénéfice imposable et la fortune imposable sont déterminés de la même manière au niveau cantonal. Si une entreprise de personnes ne tient pas de comptabilité commerciale, ses associés ou associés commandités sont tenus, conformément à l’art. 125 al. 2 LIFD, d’établir au moins un état de l’actif et du passif, des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (cf. également l’art. 957 al. 2 CO).
- Le bénéfice imposable déterminé pour l’entreprise de personnes ainsi que la fortune imposable déterminée sont attribués dans un deuxième temps au propriétaire dans le cas d’une entreprise individuelle ou proportionnellement aux associés dans le cas d’une société en nom collectif, puis imposés avec le reste de leur revenu et de leur fortune. L’imputation proportionnelle du bénéfice et de la fortune d’une société en nom collectif aux différents associés est régie par la répartition des bénéfices et des pertes convenue dans le contrat de société.
La transparence et ses conséquences
Grâce à cette transparence, les revenus et la fortune des entreprises individuelles ne sont imposés qu’une seule fois, au niveau du propriétaire ou des associés. Il en résulte les conséquences suivantes :
- Il est nécessaire de faire la distinction entre la sphère professionnelle et la sphère privée, notamment en ce qui concerne :
- Distinction entre patrimoine privé et patrimoine commercial
- Le bénéfice réalisé au niveau de l’entreprise ne peut pas être laissé dans l’entreprise (réinvesti). Il est imposé dans son intégralité au moment où il est réalisé, soit dans l’entreprise, soit chez les associés.
- Les bénéfices et la fortune de l’entreprise sont imposés avec le reste du revenu et de la fortune du ou des associés, étant entendu que :
- DLes pertes commerciales subies au cours de la période fiscale peuvent être compensées avec les autres revenus du contribuable (compensation intra-périodique des pertes). Les entrepreneurs individuels ne sont donc soumis à la compensation inter-périodique des pertes conformément à l’art. 211 LIFD ou à l’art. 31, al. 1, LIFD que si les pertes n’ont pas déjà pu être compensées intra-périodiquement.
Exemple: Michel Favre a réalisé une perte de CHF 10 000 avec son entreprise individuelle. Sa femme Jacqueline avait encore un petit emploi à temps partiel et avait gagné CHF 3’000 la même année. La perte de l’entreprise individuelle est désormais compensée par les revenus, ce qui signifie que Michel et Jacqueline ont un revenu net de CHF 0 pour cette année et peuvent compenser les CHF 7’000 restants avec les revenus des années suivantes.
- Les associés doivent verser des cotisations AVS sur les bénéfices de l’entreprise.
Distinction entre patrimoine commercial et patrimoine privé
Le patrimoine commercial et le patrimoine privé sont soumis à des principes d’imposition différents, tant en ce qui concerne l’imposition du revenu que celle de la fortune. La distinction entre le patrimoine commercial et le patrimoine privé d’un entrepreneur individuel constitue donc un thème central du droit de l’impôt sur le revenu, notamment pour les raisons suivantes :
- Seuls les gains en capital réalisés sur la fortune commerciale sont imposables (art. 18 al. 2 LIFD), mais pas ceux réalisés sur la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD).
- Seuls les actifs commerciaux peuvent faire l’objet d’amortissements, de corrections de valeur et de provisions (art. 27 al. 2 let. a LIFD), mais pas les actifs privés.
- Seules les pertes en capital sur la fortune commerciale peuvent être déduites du revenu imposable (art. 27 al. 2 let. b LIFD), mais pas celles sur la fortune privée.
- Seuls les intérêts sur les dettes commerciales sont déductibles sans restriction (art. 27 al. 2 let. d LIFD), les intérêts sur les dettes privées ne sont déductibles que de manière limitée (art. 33 al. 1 let. a LIFD).
Selon la définition légale, le patrimoine commercial comprend tout ce qui sert effectivement à l’activité lucrative indépendante. L’utilité effective doit être déterminée sur la base de l’utilisation actuelle du bien patrimonial et de sa fonction technique et économique dans l’entreprise.
Dépôts privés et retraits privés
Dépôts privés
Dans les sociétés de personnes, les apports en capital prennent généralement la forme d’apports privés. Il y a apport privé lorsqu’une personne physique transfère un élément patrimonial de sa fortune privée à sa fortune commerciale. L’élément patrimonial doit être inscrit au bilan de l’entreprise à sa valeur vénale (valeur marchande) au moment de l’apport privé. En raison de l’exonération fiscale des gains en capital privés, l’apport privé n’entraîne pas d’impôt sur le revenu pour les particuliers. Dans certains cantons, toutefois, il peut donner lieu à un impôt sur les gains immobiliers. Dans les sociétés de personnes, il peut également y avoir des apports d’usage. Il y a apport d’usage lorsqu’un associé d’une société de personnes renonce à une rémunération conforme au marché pour une prestation fournie à l’entreprise.
Exemple: Michel Favre accorde un prêt à sa société en nom collectif sans exiger d’intérêts. Cet apport en nature n’a aucune incidence fiscale pour sa société en nom collectif, car la société de personnes réalise un bénéfice supérieur au montant des intérêts auxquels elle renonce.
Retraits privés
On distingue trois types de prélèvements sur le capital dans les sociétés de personnes :
- Les retraits du compte de capital et du compte privé n’ont aucune incidence fiscale. Ils n’ont aucune incidence sur le compte de résultat de l’entreprise et sont donc fiscalement neutres.
- Lorsque l’entreprise supporte des charges privées, par exemple lorsque l’entrepreneur fait payer par l’entreprise le loyer de son appartement privé, il prélève sur l’entreprise un bénéfice non encore imposé. Du point de vue de l’entreprise, il s’agit de charges non justifiées par l’exploitation, qui doivent être corrigées dans le compte de résultat et ne peuvent être déduites (art. 27 al. 1 LIFD). Le bénéfice réalisé par l’entreprise et imposable par l’entreprise de personnes augmente donc du montant des dépenses privées non déductibles.
- Il y a prélèvement privé lorsqu’une personne physique transfère des éléments de la fortune commerciale dans sa fortune privée (art. 18 al. 2 2e phrase LIFD). Le prélèvement fait passer l’élément de fortune dans un domaine non imposable, car les gains en capital réalisés sur la fortune privée sont exonérés de l’impôt, contrairement à ceux réalisés sur la fortune commerciale (art. 16 al. 3 LIFD). En cas de retrait d’éléments de fortune mobiliers, le revenu imposable correspond à la différence entre la valeur vénale et la valeur fiscale du revenu de l’élément de fortune retiré.
Exemple: Michel Favre souhaite désormais utiliser son véhicule professionnel uniquement à des fins privées. Il le transfère donc de son patrimoine commercial à son patrimoine privé. Dans la comptabilité de son entreprise individuelle, le véhicule est enregistré à CHF 1.- (valeur fiscale). Selon l’évaluation EuroTax, la voiture vaut toutefois encore CHF 10’000.- (valeur vénale). Michel doit donc transférer le véhicule dans sa fortune privée à CHF 10’000 et déclarer les réserves latentes réalisées de CHF 9’999.- comme chiffre d’affaires dans son entreprise individuelle.
L’essentiel en bref
- La taxation fiscale s’effectue en deux étapes
- Détermination du bénéfice imposable de la société de personnes
- Le bénéfice imposable de la société de personnes est ajouté au revenu du propriétaire.
- Distinction entre patrimoine privé et patrimoine commercial
- Différents principes d’imposition
- Les bénéfices ne peuvent pas être thésaurisés.
- Les pertes sont compensées par les autres revenus, si ceux-ci ne suffisent pas, par les revenus des périodes fiscales suivantes.
- Apports privés dans la société de personnes exonérés d’impôt
- Les prélèvements privés sur le patrimoine commercial sont en principe exonérés d’impôt.
- Exceptions : les dépenses privées sont comptabilisées dans le compte de résultat de l’entreprise ; retrait d’actifs de l’entreprise.
Vous êtes prêt ?
Créez votre entreprise maintenant.
Notre équipe a déjà aidé des milliers de créateurs d'entreprise à lancer leur entreprise.
Rapidement, avec le meilleur service et aux meilleurs prix.